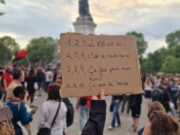La France a connu de 1789 à 1815 des années qui ont à jamais changé sa physionomie sur tous les plans : 25 ans de guerres civiles et de guerres étrangères, de bouleversements culturels, économiques, religieux, sociaux…
Le Nord et le Pas-de-Calais n’ont pas été épargnés par certains soubresauts dont la « Pensée officielle » évoque rarement le souvenir : par exemple, la « Petite Vendée de l’Artois » en 1793 et la « Chouannerie flamande » en 1813. On vous explique ces événements peu connus via Pernes ou encore Merville. Plusieurs points communs dans les deux cas : soulèvement contre les abus du pouvoir en place, monde paysan excédé, conscription, « jacqueries », répression…

Terreur en Ternois avec les émeutes royalistes
La Terreur jacobine a déclenché dans toute la France de petites révolutions contre la « Grande Révolution », la plus connue étant celle de Vendée, suivie d’un génocide (cf. Le Puy du Fou). Mais celles de Franche-Comté, des Monts du Languedoc, de la Brie, de Bretagne, du Sancerrois, du Vendômois etc. ont également laissé des traces dans la mémoire populaire, même si les historiens académiques les ont souvent minimisées.
Les « émeutes royalistes » de l’été 1793 dans le Ternois (Pas-de-Calais) ont commencé par des rassemblements de jeunes paysans qui refusaient la « levée en masse » et manifestèrent lors de la ducasse d’Aumerval, puis dans les autres villages autour de Pernes. Les familles rurales voyaient d’un mauvais œil le départ des jeunes hommes vers des champs… de batailles, alors que la moisson avait besoin de bras.
Dans les campagnes, on ne comprenait pas les persécutions contre les prêtres ni le « martyr du roi » six mois plus tôt. Le dimanche 25 août 1793, à Aumerval, Floringhem, Nédonchel, Sachin etc., de jeunes cultivateurs refusent de partir à Saint-Pol-sur-Ternoise pour la « Réquisition militaire » ; à eux se joignent des soldats déserteurs.
Après une journée bien arrosée, agrémentée de propos et d’actes antirépublicains (sciage d’arbres de la liberté, piétinement des cocardes tricolores), les plus motivés, certains armés de bric et de broc, rejoignent les bois qui couronnent les collines environnantes. Les meneurs supposés seraient issus d’une famille très connue de Pernes, ardents monarchistes, les Truyart : Pierre, notaire royal, et son frère Philippe.

Guillotine, mémorable machine
Des « bleus » filent en cachette dénoncer les « blancs » et prévenir non seulement le citoyen Augustin Darthé, commissaire du district, mais le général Ferrand à la garnison de Béthune, enfin le tristement fameux Joseph Lebon à Arras. Aussitôt 6000 « patriotes », soldats et gardes nationaux réunis depuis Frévent, Hesdin, Aire etc. convergent vers le secteur de Pernes. Environ 300 jeunes révoltés sont rapidement arrêtés, les autres se dispersent.
La répression commence : 17 hommes et 2 femmes sont guillotinés devant l’église de Saint-Pol, 50 autres jetés en prison, des familles proscrites émigrent en Belgique.
Extrait d’une lettre de Darthé à la Convention : « Je ne finirais pas si je voulais vous retracer tous les actes de patriotisme dont mon âme est encore émue… » et de Lebon à sa tendre épouse : « L’exemple sera tel qu’il intimidera les pervers et les aristocrates jusqu’à la vingtième génération… » Il a illico fait venir son cher « rasoir national » dans ce secteur, mais les roues de la charrette se faussent devant Cauchy-A-la-Tour.
En attendant la réparation, la prédiction de Lebon s’est réalisée : le spectacle de cet instrument a tellement frappé la population que cet endroit est toujours nommé le « Carrefour de la guillotine » !

« Louis XVII » à Merville !
La petite Chouannerie flamande démarre le 22 novembre 1813 à Hazebrouck, avec le sac de la sous-préfecture : c’est le « stokken moendag » (le lundi des bâtons !) La Grande Armée a fondu dans les neiges de Russie et la bataille de Leipzig. Ensuite est arrivé l’ordre de mobilisation d’un contingent de 350 000 hommes demandé par l’Empereur pour défendre les frontières. Des centaines de jeunes conscrits du Nord refusent de rejoindre les centres de Dépôt. Le mois suivant, apparaît un cavalier à cocarde blanche, sabre et pistolets à la ceinture. Il semble prendre l’ascendant sur tous ces mobilisés qui refusent de partir à nouveau à la guerre.
Son nom, Louis Fruchart ; il est né, dans une famille paysanne demeurée ardemment royaliste, à la ferme du Robertmetz entre Neuf-Berquin et Merville en 1791. Ce solide gaillard – dont plusieurs frères sont déjà incorporés – va prendre avec son père la tête d’une véritable insurrection armée qui tiendra en échec les gendarmes et les troupes envoyés pour réprimer ces « agitateurs séditieux ».
Son quartier-général est à Estaires. Des combats fratricides entre « napoléoniens » et monarchistes vont avoir lieu dans tout ce secteur, avec des tués des deux côtés.
Quand, début 1814, les armées alliées commencent à entrer en Belgique (alors française) puis dans le Nord, ce Louis Fruchart que le peuple surnomme « Louis XVII » (en souvenir du fils de Louis XVI, le petit prince assassiné au Temple) va aller jusqu’à guider vers l’Île-de-France les régiments russes du colonel Fiodor Clementievitch Geismar ; les Cosaques, au passage, pillent à Cassel le château du général Vandamme.
Recherche tombe désespérément
Après les « Cent Jours » et Waterloo, Fruchart rejoint le roi Louis XVIII qui le nomme lieutenant des « Gardes du corps du roi ». En 1830, le « roi-bourgeois » Louis-Philippe, qui déteste les légitimistes, le licencie. « Louis XVII » retourne dans sa Flandre et mourra à Lestrem en 1851. Ses descendants cherchent toujours sa tombe…
Jean-Louis Pelon
Source link